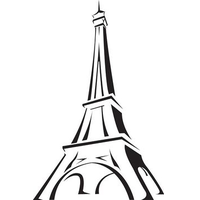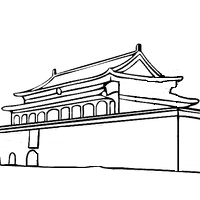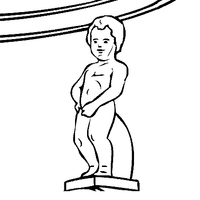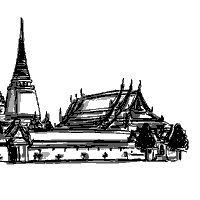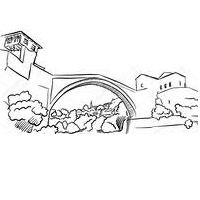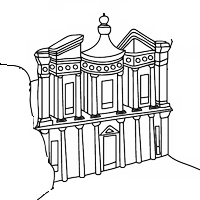L'Egypte étant un pays fortement religieux, l'Islam régit un grand nombre d'actes de la vie quotidienne. Il n'est donc pas anormal de rappeler les quelques principes de la religion islamique, avant tout.
Principes de la religion islamique
L'islam (le mot signifie en arabe «soumission à Dieu»), c'est aujourd'hui une communauté regroupant environ le sixième de l'humanité, fédérée par son adhésion à la religion «révélée» à Mahomet en Arabie au VIIe siècle de notre ère. L'islam ne distingue pas le temporel du spirituel. Son dogme, ses institutions et sa législation sont fondés sur le Coran, enrichi de la sunna, recueil des paroles et des actes du Prophète. Il repose sur une profession de foi monothéiste : « Il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, et Mahomet est son prophète.» La pratique religieuse exige l'accomplissement par le musulman de cinq obligations rituelles, appelées les « cinq piliers de l'islam » : la profession de foi déjà citée, les cinq prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, l'acquittement d'une «aumône légale», destinée à couvrir certaines dépenses d'intérêt public (fonds de secours mutuel...), enfin, l'accomplissement du pèlerinage à La Mecque. Au rang des devoirs non plus individuels mais collectifs figure le djihad, au double sens d'effort personnel et de la «guerre sainte» qui doit aboutir à étendre le règne de la loi musulmane et connaît aujourd'hui un regain d'actualité.
La vie quotidienne
L'Egypte politique
La République arabe d'Egypte est la R.A.E. pour les amateurs de sigles. Son drapeau se compose de trois bandes horizontales aux couleurs rouge, blanc et noir. La bande blanche est frappée en son milieu par un aigle doré. Cet aigle remplace depuis octobre 1984 le faucon, qui s'était lui-même substitué à l'étoile qui orna d'abord la bande médiane.
La Constitution du 11 septembre 1971, plusieurs fois modifiée, régit le pays. Le président de la République est élu pour six ans au suffrage universel. La restriction qui lui interdisait de renouveler son mandat plus d'une fois a été supprimée. La suppression de cette limitation est intervenue avec la révision de la Constitution de mai 1980, ouvrant au raïs la perspective d'une «présidence à vie».
Le chef de l'État nomme les membres du gouvernement et le Premier ministre. Il peut cumuler sa fonction présidentielle et celle de Premier ministre.
L'Assemblée du peuple dont 53% sont composés de paysans est élue pour cinq ans. Le dernier renouvellement a eu lieu en 1985.
Les 360 sièges que compte cette assemblée sont détenus par les représentants des différents partis qui se partagent l'opinion. Le Parti national démocratique, présidé parle chef de l'État, est le mouvement dominant Les instances de ce parti comprennent un comité exécutif de 10 membres, un comité central de 230 membres et un congrès national qui en représente l'autorité souveraine.
Le territoire égyptien est divisé en vingt-cinq circonscriptions administratives, les gouvernorats, eux-mêmes subdivisés en 4 033 villages, équivalents de nos communes.
Comme au temps des pharaons
Deux mille ans d'oubli, l'intervention de profonds changements politiques, le chamboulement des croyances, rien n'y a fait. En Egypte, le temps des pharaons palpite toujours sous les éboulements de l'Histoire.
Et le vieux peuple nilotique reste attaché au panthéisme du temps de Rê, le dieu Soleil, d'Osiris le dieu de la Végétation, ou de Ptah, le dieu de Memphis, créateur de l'Œuf, que la nature immuable lui rappelle chaque jour. Et il côtoie Apis, le dieu bovin, et Horus, l'épervier fulgurant. Sur les rives du Nil, le grincement des chadoufs, les fellahs vêtus de leur robe de coton, le sarclage des terres ou la réparation des digues perpétuent des spectacles, des gestes et des sons qui existaient déjà voici quatre mille ans. Les fresques que conserve l'abri des mastabas en témoignent.
Peut-être aussi faut-il chercher très loin dans l'inconscient de ce peuple ce goût pour la fonction publique. Déjà Bonaparte avait constaté à son arrivée en Egypte: «Dans aucun pays du monde, l'administration n'a autant d'influence sur la prospérité publique qu'en Egypte. » Une leçon que n'ont pas oubliée les descendants des scribes.
Mais, si ce climat psychologique laisse libre cours à la discussion, il est des gestes, des rites, enracinés dans la tradition des fellahs et qui renouvellent des pratiques du temps des pharaons.
Dans ce pays pétri par les millénaires, les traditions sont tenaces. Ainsi certaines fêtes paysannes, en relation avec la crue du Nil — et qui remontent sans doute aux origines —, sont encore célébrées. Certes la régulation apportée par le haut barrage en a supprimé la cause. Mais les fellahs continuent de célébrer la nuit de la Goutte qui honorait déjà la montée des eaux à l'époque de Ramsès II et la coupure des digues que l'on ne pratique plus.
A chaque traversée du Nil, les marins des felouques accomplissent un geste rituel. Ces nommes du fleuve retrouvent ainsi le temps où, avant d'être musulmans, leurs ancêtres vénéraient Osiris, Rê ou Nout, les dieux des éléments naturels. Une femme prélève un peu d'eau du fleuve dans une écuelle et l'offre à l'équipage. Cette coupe rustique passe de main en main et chacun boit un peu de cette eau. C'est la marque du profond respect que les riverains portent à l'eau du Nil. Une eau que les fellahs ne filtrent jamais... pour ne pas lui ôter la vie.
Ce geste presque anodin serait incompréhensible séparé de sa référence antique: les cérémonies de la fête d'Opet, symbole de la Fécondité. Cette fête était célébrée vers la fin de septembre lorsque le Nil déversait sa crue fertilisante. La statue d'Amon, extraite du naos du temple de Karnak, était alors placée sur une barque sacrée avec tous les signes de révérence. Et notamment elle était aspergée d'un peu d'eau du fleuve. La barque était suivie de trois autres embarcations dans l'une desquelles trônait la statue du pharaon régnant. Le cortège remontait le fleuve jusqu’au temple de Louqsor, où les barques étaient portées à dos d'hommes jusqu'au sanctuaire. Là, elles étaient déposées dans des chapelles. Dix jours plus tard, le cortège défilait en sens inverse. Ces dix jours avaient suffi pour qu'Amon fécondât Mout, son épouse, en son «harem méridional». Aujourd’hui encore, à Louqsor, une fête musulmane célèbre la belle saison... en promenant une embarcation dans les rues.
Pour les fellahs, le limon du fleuve où se conjuguent la terre et l'eau symbolise le principe de vie. Avant la délivrance, la femme enceinte du fellah prélève sur la berge même du fleuve un peu de terre qu'elle avalera pendant l'accouchement. Ce geste furtif lui promet d'obtenir une heureuse naissance.
Après la naissance, et si tout s'est bien passé, le placenta de la parturiente sera enterré dans le sol en terre battue de sa maison et le cordon ombilical, symbole de fécondité, enfermé dans un sachet avec quelques semences de céréales, sera enfoui dans le champ du père.
Ce qui est bon pour les humains est valable pour les végétaux. Le soleil et la terre réunis font lever au printemps des primevères qui envahissent les marchés d'Alexandrie et du Caire. Saison du renouveau, des premiers fruits, des légumes primeurs. Alors, l'Egypte fête le Printemps. C'est Cham al-Nassim, littéralement «Senteur de la brise». Cette fête du printemps, dont la date est fixée au premier lundi après la Pâque copte, renouvelle des rites païens que l'on pratiquait au temps des pharaons. L'Egypte entière est dans la rue. Chrétiens, coptes et musulmans se mêlent pour célébrer la renaissance du soleil et de la fécondité. Le dieu Rê n'est pas encore levé que les femmes commencent à suspendre des bottes d'oignons au-dessus de leur porte d'entrée. Puis elles choisissent le plus juteux d'entre eux et en frottent le nez de leurs enfants. Les yeux s'embuent, les larmes coulent Elles chassent les mauvais esprits. Et tant pis pour ceux qui dorment encore en cette heure matinale; l'année, pour eux, sera paresse.
Oui ! Ces manifestations naïves rejoignent les cérémonies pharaoniques. Les oignons étaient offerts au dieu de la Végétation, Osiris.
Il faut se promener sur les chemins ocre et poussiéreux de la campagne nilotique pour retrouver à présent l'Egypte éternelle, contrebattue par le modernisme. Mais, au hasard des villages rencontrés, on déniche encore des dépouilles de crocodile clouées sur les portes des maisons. Contre le mauvais œil.
Gestes-symboles qui jalonnent la vie, de la naissance à la mort, échos lointains d'un passé prestigieux. Faut-il n'y voir que des cérémonies fossilisées, des bribes de souvenirs, des avatars des vieux rites propres à l'ethnologie égyptienne ? Peut-être pas.
Rappelons, à cette occasion, que la légende d'Ali-Baba et les Quarante Voleurs, telle que Galland l'avait rapportée dans sa traduction des Contes des mille et une nuits n'avait été transmise que par des récits oraux. La transcription arabe en a été découverte en 1910 et son texte doit être originaire d'Egypte si l'on en juge par le style et par la langue. Ce qui permet de supposer que la légende d'Ali-Baba, elle aussi, est peut-être un héritage du temps des pharaons. D'après les plus éminents égyptologues, il s'agirait des aventures d'un personnage historique, nommé Thoutii, qui vivait au temps du pharaon Thoutmosis III. Ce Thoutii qui était général s'était rendu célèbre par la ruse qu'il employa pour s'emparer de Jaffa. Cette ruse est relatée sur un papyrus : le rusé Thoutii parvint à introduire dans la place, en les dissimulant dans 500 corbeilles, des guerriers qui l'aidèrent à s'emparer de cette place forte.
Habitat et objets usuels
«Ce sont les mêmes misérables villages, construits avec la même terre brute du limon du Nil mêlée aux feuilles de mais et au fumier du bétail, et toujours habités par la même population analphabète, affamée, usée et décimée par les maladies. Rien n'est différent, rien n'a évolué...» Depuis que Tawfik al-Hakim a tracé ce tableau désabusé de la vie rurale dans le Delta, au fil des pages de son journal d'un substitut de campagne, certains aspects des villages ont conservé leurs caractères millénaires. Les bourgs tapis au bord du fleuve sont toujours invisibles, à l'ombre des palmeraies bruissantes d'oiseaux. Au petit matin, la même rumeur s'élève des champs de coton, la chanson d'un fellah, heureux de vivre, heureux de sentir la fraîcheur qui l'environne, le meuglement d'un buffle ou le braiment d'un âne.
Dans cette campagne façonnée par le Nil, chaque arpent de terre humide est réservé aux cultures. Les habitations n'ont pas le loisir de se disséminer. D'ailleurs, le fisc a veillé, dès le temps des pharaons, à ce que les fellahs restent groupés. Tout le monde y a trouvé son compte. Les amateurs de convivialité aussi bien que les gens pieux, heureux d'être proches de leur mosquée; et même le fellah ordinaire, parce que ce regroupement assurait jadis une meilleure protection contre les raids des Bédouins. Cette répartition demeure sensible dans le Delta et dans la Haute-Egypte. Le long de la Moyenne Vallée, un certain modernisme commence à inciter à la dissémination des exploitations rurales. Encore que le fellah ne soit pas autorisé à construire sa maison ailleurs que sur les terres stériles, en bordure du désert.
Le souci de réserver la bonne terre aux cultures n'interdit pas que le village soit cerné de quelques arbres, acacias, sycomores ou tamaris, qui lui dispensent un ombrage irrégulier. On pénètre dans le bourg par le gùrm. C'est une aire de terre battue où chaque famille effectue le dépiquage de ses céréales. On y étale la récolte et l'on fait tourner la norag, le traîneau dont le patin est hérissé de lames de fer pour séparer le grain de l'ivraie. Un buffle aux yeux bandés tourne et tire ce manège rural sous la direction du fellah juché sur le traîneau. Ensuite, la paille sera séparée du grain au râteau et le grain ramassé à la pelle de bois pour être entassé dans les sacs. Le silo, chanta, n'est jamais très éloigné d'une grange communautaire, ancienne dépendance d'un grand propriétaire ou d'une banque, et généralement devenue fief d'une coopérative rurale depuis la réforme agraire. Quant au cimetière, il se situe toujours à l'écart, comme oublié dans la zone déjà désertique. Ce tableau succinct correspond au paysage nilotique. Mais le Fayoum et certains coins de la Moyenne-Egypte ajoutent au village la touche particulière d'un grand pigeonnier.
Rien de mieux adapté à l'environnement que les maisons nilotiques. Leur architecture en terre semble modelée à même le sol, se bornant à fournir quelques lignes géométriques à un paysage noyé dans la poussière. L'adobe dont elles sont faites est un isolant thermique efficace qui procure une grande fraîcheur à l'intérieur de ces constructions. Un seul inconvénient avec ce matériau : il ne permet pas d'édifier des structures en hauteur. Toute en longueur, la maison rurale égyptienne se compose de trois pièces en enfilade au rez-de-chaussée, rarement d'étage.
La première pièce, la manadara, est un lieu de réception et de travail. Le jour tamisé qui filtre par la porte, seule ouverture Habituelle de ce volume (il est parfois aussi aéré par une petite lucarne), en laisse entrevoir les quelques nattes et la banquette maçonnée qui en constituent le mobilier sommaire. Une porte de communication ouvre sur la salle commune, mi-cuisine, mi-chambre, dans laquelle trône le four où cuisent les galettes. Ne cherchez pas la cheminée : elle n'existe pas. La troisième pièce de la demeure, la zeriba, est souvent indépendante, mais parfois ne communique avec l'extérieur que par l'intermédiaire des deux pièces précédentes. Cette disposition ne laisse pas d'être gênante lorsqu'on sait que la zeriba sert d'étable où dorment l'âne et le buffle.
Le toit plat est fait d'un torchis nappé sur des entrelacs de roseaux soutenus par quelques solives. Cette couverture isole du soleil et sert de séchoir où s'entassent les fagots et les guillas, les galettes de bouse et de paille hachée qui serviront de combustible.
À ce plan type, le fellah peut adjoindre d'autres pièces lorsque sa maisonnée s'agrandit par naissance ou par mariage ou encore par acquisition de bétail.
Seules les villes rompent cette tradition de l'habitat et introduisent la pierre et le ciment dans leur architecture. Les villes et Gournah !
New Gournah est le chef-d'œuvre d'Hassan Fathy, «l'architecte des fellahs». Pour ce Le Corbusier égyptien, «une maison est une œuvre essentiellement collective », que les utilisateurs doivent construire eux-mêmes, un village où «les habitants doivent vivre aussi naturellement qu'ils portent leurs vêtements». Un millier d'habitations ont été ainsi construites entre 1946 et 1948. Le matériau employé est la brique de boue, la tûb. Cette école égyptienne d'architecture s'est fait connaître depuis par des réalisations en Egypte et ailleurs. Les «voûtes nubiennes » en brique de terre, se sont élevées même aux États-Unis où Hassan Fathy a fait surgir une mosquée dans le désert du Nouveau-Mexique. En Egypte même, sa coopérative agricole de Baris, construite en 1963 dans l'oasis de Kharga (Kharguëh) inscrit ses « structures à climatisation naturelle » dans le cadre de l'aménagement de la Nouvelle Vallée. Elles voisinent avec la nécropole pharaonique de Bagawat, édifiée 1 500 ans avant JC. Avec la même technique de la brique crue !
Pour avoir tenté, dès les années 40, un retour aux sources écologiques, pour l'avoir proclamé dans Construire avec le peuple paru en 1970, Fathy fait figure de précurseur. Son expérience, trop novatrice pour réussir à Goumah, apparaît aujourd'hui chargée d'intérêt pour les pays en voie de développement.
Le fellah, le chauffeur de taxi, le fonctionnaire et les autres
De l'aube à la nuit, le travail mobilise toute la famille dans la campagne égyptienne. Personne n'y échappe. Même les enfants. En dehors des heures de classe (quand il y en a), les moins de douze ans au crâne rasé ont la charge de s'occuper des buffles, des poules et des poussins. A travers cette mission pastorale, les petits Égyptiens du Delta ou de la Vallée apprennent ainsi les dures réalités de la vie rurale.
Plus âgé, le gamin perdra sa belle liberté de courir à travers les ruelles du village ou derrière les haies de roseaux. Son emploi du temps, fixé par la tradition, lui assignera des besognes à accomplir dans la fraîcheur relative de la maison. Sa mère, la fellaha, s'y affaire, jamais très éloignée de la précieuse fist, la bassine plate, le récipient à tout faire. Cette cuvette a servi à la toilette et à la lessive. Elle est utilisée à présent pour trier le grain ou les fèves. Tout à l'heure, elle contiendra la pâte qu'il faudra pétrir longtemps pour confectionner le bettaw, la galette de maïs, le «pain de soleil».
Le fellah, de son côté, bricole, répare les outils, tresse des sangles en vannerie. C'est à lui qu'appartient le rôle de représentation extérieure de la famille. C'est donc lui qui ira au marché vendre les œufs frais, les mangues, les poulets, les poivrons, lui qui négociera des trocs interminables, lui enfin qui achètera ou vendra le buffle pour tirer la charrue, ou l'âne qui sert de moyen de transport.
Tandis que les pigeons roucoulent à l'ombre des tamaris et que les poules gloussent, invisibles, les heures chaudes s'égrènent comme dans un roman de Tawfiq al-Hakim. Sur la place du village opère le mizaïen qui est à la fois le barbier, l'apothicaire et le dentiste. À l'ombre d'un palmier, le baqqal, l'épicier-limonadier, fait crédit... à des taux usuraires. L'arrivée des chaer, les musiciens ambulants, déchaîne les galopades d'une meute d'enfants. Il n'y a pas mieux qu'un chaer pour raconter la vie de Mahomet en palpitants épisodes. Il sait tenir en haleine, des heures durant, enfants et parents, accroupis sur le seuil des maisons. Au crépuscule, les musiciens joueront du rabab, la viole simple, de la flûte faite d'un roseau du Nil ou du canûn, la cithare.
Comme pour satisfaire les amateurs d'éternité, les felouques aux voiles triangulaires qui glissent sur les eaux du neuve reproduisent en version nautique ces scènes de genre dont la campagne égyptienne est si peu avare. Mais la plus Immuable de ces manières de vivre, on la trouve surtout sur les crêtes pelées de la montagne arabique ou dans les déserts minéraux du Sinaï. Là, des tribus de Bédouins vivent encore comme aux premiers âges, nomadisant derrière leur troupeau de chèvres à la recherche de pâturages frais. On les voit descendre jusqu'aux eaux immenses de la mer Rouge ou du golfe d’Aqâbâ, eux, les bergers des terres arides. Ils campent ainsi quelques jours sous leurs tentes brunes. Et leurs femmes, longs fantômes vêtus de noir, vont et viennent, cliquetant de tous leurs lourds bijoux de bronze. Puis, discrètement, comme ils sont venus, ils repartent, quittant le rivage presque doux pour l’âpreté des montagnes. Parce que tel est le décret que les millénaires fixent à ces hommes du néant. À l'opposé de ces mœurs bibliques, la vie urbaine grouille, vibre, explose. Et surtout au Caire, la capitale saisie de démence, où douze millions d'habitants se disputent l'espace vital. Ici, l'errance est celle des squatters qui colonisent les abris publics, les toits en terrasse, les immeubles en construction.
Près d'un million d'entre eux ont élu domicile entre les tombes et les mausolées de la Cité des Morts, le cimetière qui est au bout du boulevard périphérique.
Il faut surveiller les immeubles. Ainsi le 'baùb, le portier des quartiers riches, qui dort sous les escaliers ou sur le trottoir, occupe-t-il une place déjà éminente dans l'échelle sociale de ces villes livrées à la survie.
Ici, le négoce est roi. Une charrette sert d'étal, le moindre recoin, d'atelier. Le pôle de cette activité trépidante et nécessiteuse se tient au bazar, monde à part, labyrinthique, profus. On trouve de tout dans ses ruelles spécialisées, le souk des épices, celui des ferblantiers, celui des pâtes alimentaires ou de la bimbeloterie domestique. On y trouve aussi de la couleur, des odeurs et de l'ombre. Le bazar du Caire, le Kan al-Qhalili, figure d'ailleurs parmi les étapes obligatoires d'une visite touristique à travers la capitale égyptienne, un concentré de sa vie grouillante.
Dans les autres villes du pays, le bazar concentre plutôt les conciliabules du négoce local. Pour régler les affaires importantes ou pour passer un moment, les hommes s'attablent au café. On y sirote le thé à la menthe ou l'une des trois sortes de café : sans sucre, peu sucré ou très sucré.
Pour se désaltérer, le marchand ambulant suffit. Les clochettes qui signalent son passage attirent la clientèle. Dans un réservoir en cuivre ou en fer-blanc qu'a porte comme un sac à dos, il trimbale de délicieux breuvages : Vassab, jus de canne à sucre, le qarqadeh, infusion de fleurs séchées, le ressous, eau de réglisse. Il remplit de petits verres qu'il porte sur un minuscule établi, bouclé sur son ventre comme un tablier. Le marchand de boisson fait partie du spectacle de la rue égyptienne au même titre que le chauffeur de taxi soucieux d'orner son véhicule de mille et un gadgets « made in Hongkong» : minuscules poupées en plastique, plumes multicolores, guirlandes, moulinets, etc., qui métamorphosent les taxis égyptiens en petits musées kitsch.
Tandis que l'un déambule à pas lents, au son de ses grelots, l'autre démarre en trombe, la voiture surchargée de clients, Klaxon déchaîné, essieux à l'agonie lorsque la vieille Mercedes ou l'antique Dodge cahote d'une fondrière à l'autre. Mais le tumulte de la rue n'empêche pas le sage de téter la chicha, version égyptienne du narguilé, l'une des formes du savoir-vivre oriental.
Autre fruit d'une millénaire expérience, la prolifération des fonctionnaires chez les descendants des scribes. Dans les services administratifs, un personnel pléthorique s'efforce à longueur de vie de justifier ses émoluments par une décomposition de la tâche, une hyperspécialisation du tampon, du préposé au tampon, du bureau compétent, du service responsable, signifiant pour l'usager des ajournements Kafkaïens au milieu d'une bureaucratie labyrinthique. Il faut tout l'humour de l'Égyptien pour accepter cet état de fait. «Si tu veux être respecté, dit une maxime, ne sois ni paysan, ni soldat, ni prêtre, sois fonctionnaire. »