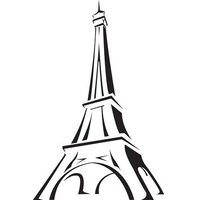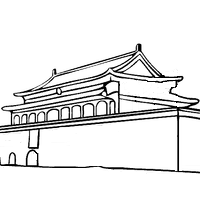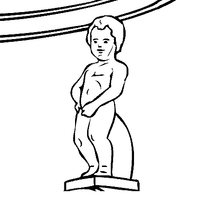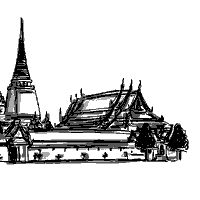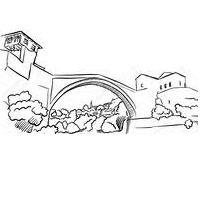En Egypte, un sens aigu de la convivialité réoriente les règles prescrites par le Coran pour gouverner les rapports sociaux qui jalonnent la vie quotidienne. Il en est ainsi de la naissance et de la mort, du mariage et du divorce.
La convivialité à l'égyptienne
Bien qu'atténué dans les villes, le sentiment demeure vivace dans les campagnes d'estimer chaque naissance comme un renfort de la famille. La naissance est attendue, espérée. La femme qui accouche d'un garçon sera particulièrement choyée. Le voisinage viendra lui rendre visite, la féliciter, s'enquérir de sa santé. La famille, lisez la belle-mère, n'hésitera pas à offrir aux visiteurs le mùrat, l'infusion de camomille. Au septième jour, on allumera sept bougies en attribuant à chacune un prénom. C'est au père de souffler. Geste rituel mais important, car la dernière bougie allumée indiquera le prénom que portera le bébé. Il faut reconnaître que ces courtoisies post-natales se perdent quelque peu à mesure que la famille voit se multiplier les naissances.
Le décès impose, lui aussi, à la famille égyptienne certains comportements. Elle doit dresser une tente de couleurs vives dans la rue, devant la maison mortuaire, et, durant trois jours, les hommes de la famille y reçoivent les visites de condoléances en buvant le café amer en signe de deuil. Dans le Delta et la campagne nilotique, depuis le temps des pharaons, subsiste la coutume de déposer auprès du mort un pain et une cruche de bière. Le jour des funérailles, la dépouille mortelle enveloppée d'un linceul de coton est placée dans le cercueil. Celui-ci est dépourvu de couvercle. Et certains veulent voir dans cette pratique une survivance du rituel pharaonique où le sarcophage reproduisait le visage du mort. L'inhumation réunit les pleureuses qui hurlent et s'aspergent le visage de poussière. Les hommes portent le cercueil jusqu'au cimetière. La dépouille mortelle est extraite du cercueil et inhumée sous une simple stèle.
Les Egyptiens des campagnes pensent que l'âme du défunt continue d'errer pendant quarante jours. Aussi, à l'échéance de ce délai, un proverbe dit que le cartilage du nez tombe. Cette circonstance occasionne un renouvellement des condoléances. Après quoi, la vie peut reprendre ses droits.
Mariages et divorces
Le mariage, lui aussi, représente l'un des points forts de l'existence. Il est la conclusion d'accordailles réglées par les traditions et non par la volonté des conjoints. Pour sceller cet accord étranger à tout consentement des futurs époux, les pères doivent se serrer la main et réciter un passage du Coran. Ce sont eux encore qui rédigent le contrat de mariage et fixent la date des fiançailles. Le fiancé est tenu d'offrir le shabcfâ, cadeau à sa promise. Il doit aussi lui passer au doigt un anneau de fiançailles qu'elle portera à la main droite jusqu'au jour du mariage. La veille du grand jour, la jeune fille se passe les paumes des mains et la plante des pieds au henné comme présage de bonheur. Le jour de la cérémonie arrive. On transporte le trousseau de la jeune fille (meubles, vaisselle, literie, vêtements) entassé sur des charrettes. Plus il y en a, plus elle est riche. On défile à travers le village aux accents joyeux d'une fanfare. La liesse et la curiosité publiques accompagnent ce défilé jusqu'à la nouvelle demeure de la mariée. Durant toute cette cérémonie, la mère de la mariée porte un voile sur le visage. Charmante coutume pour éviter à son futur gendre d'imaginer l'outrage des ans sur des traits si proches de ceux de la mariée. La nuit de noces, la doqhla, ne comporte aucune pratique de charivari. Mais, le lendemain matin, en apportant le petit-déjeuner traditionnel, la belle-mère entre dans ses fonctions de chef de famille. Sa bru lui doit soumission. C'est elle qui va régner sur le jeune ménage. Jadis, ce règne s'étendait à une maisonnée plus vaste. Car la polygamie admise dans le Coran était une pratique courante en Egypte. Aujourd'hui, si la loi permet toujours la pratique ancestrale, elle ne l'encourage pas. La femme peut demander le divorce si le mari prend une seconde épouse.
En revanche, la répudiation et le remariage sont très courants en Egypte.
Jusqu'en 1976, le mari pouvait dissoudre unilatéralement le mariage en prononçant par trois fois et en public le rituel Talaq, «Je te répudie». La femme n'avait plus qu'à retourner chez sa mère. Aujourd'hui, le mari est contraint d'assurer l'entretien de sa femme et de ses enfants. Ces règles sont d'ailleurs contestées par certains intégristes musulmans.
Joie de vivre
A l'opposé, on ne saurait passer sous silence la gaieté quotidienne. Il faut voir un embouteillage au Caire et les scènes de théâtre qu'il suscite. Il faut avoir vu un spectacle de «music-hall» dans le quartier de l'Opéra, pour comprendre l'authenticité de cette foule. Contes et acrobaties y alternent avec des numéros de chant et de danse dans une ambiance de fête populaire, très éloignée de l'âpreté mercantile que rencontre l'étranger.
Formules usuelles du parler égyptien
L'Égyptien a le sens des rapports sociaux. La très longue histoire d'une société profondément hiérarchisée, des siècles de domination arabe, turque et britannique, une emprise millénaire du fonctionnaire sur le simple sujet, ont éduqué l'Égyptien. Fellah ou négociant de la ville, il a appris à manifester les apparences de la soumission, à sourire sous les avanies, à philosopher à propos des coups durs. «Danse et grimace dans la patrie des singes » résume un proverbe pour lequel la société n'est qu’une ménagerie; Rien d'étonnant dans un pays qui exalte l'inconsistance des hommes et le vide des choses à travers les exubérances et l'humour d'un théâtre populaire justement intitulé le Qhayal al-Zet, l'Ombre de l'ombre.
Toutefois, si la contrainte se fait trop forte, la sagesse égyptienne prône une soumission plus forte encore. «Les coups du maître sont un honneur.» Mais, pour admettre sans broncher pareille sagesse sociale, quelle force d'âme faut-il quelque chose de bien supérieur au mekiûb du fatalisme arabe. Certes, tout est écrit dans le Grand Livre ; chaque Égyptien le sait bien. Mais il sait aussi y mettre du sien.
Et maintes formules usuelles confirment ce pacifisme inné des rapports sociaux. L'un de ces aphorismes conseille, par exemple: «Si l'équipage du maître passe et que tu le manques, roule-toi dans la poussière.» Peut-être faut-il voir dans cette acceptation permanente de la contrainte une manière de vivre imposée par la nature.
«Le soleil brûle pour nous», faisait déjà remarquer un proverbe saïte. Quelle qu'en soit l'origine, cette absence de révolte face à l'inévitable génère une morale qui n'est pas celle des autres peuples. Pour l'Égyptien, «pauvreté est pudeur, richesse débraillement. » Sans doute le dénuement qu'inspire le voisinage toujours impérieux du désert n'est-il pas étranger à cette morale ascétique.
Pourtant, l'art de vivre qui a marqué tout l'Orient arabe n'a pas laissé l'Égyptien indifférent encore aujourd'hui, le langage courant reflète cette fascination d'antan. «À la torka», à la turque, est une formule qui résume tous les raffinements de la vie comme on savait la pratiquer dans les fastueuses demeures de l'époque ottomane.
Et, même si cette vie raffinée n'intéresse jamais qu'une infime minorité de la population, le désir de bien vivre associé à la convivialité profonde de l’égyptien se traduit par un code compliqué où il entend manifester sa civilité. Entre eux, les Égyptiens échangent une quantité infinie de formules de politesse, ce que les rustres d'Occident appellent ironiquement des salamalecs. Au Kan al-Qhalili, le bazar du Caire, par exemple, aucune transaction ne saurait se conclure sans d'interminables palabres autour d'une tasse de café. Moment délectable et subtil, l'occasion de distiller les formules du savoir-vivre :
« Qahwa dayman. Sofra daynanti » «Que ce café soit étemel » ou bien Nawwart tl beitt «Tu as illuminé la maison ».
Au cours des transactions commerciales, un négociant égyptien n'hésitera pas à exprimer sa volonté de «faire cadeau » de l'objet convoité par le client. Cette formule n'est qu'une étape presque obligatoire de tout bon marchandage. D'ailleurs, il faudrait être occidental pour considérer le marchandage comme une suite d'arguments enchaînés. Pour l'Égyptien, c est l'inévitable rituel des mots, indispensable pour laisser au client le temps d'admettre le prix que le négociant s'est fixé depuis le début des pourparlers. Mais que sont les mots ? Rien, sinon un fond sonore, un brouillage pour éviter de communiquer. Priorité : se préserver.
D'une façon générale, en Egypte, le mensonge est une politesse du cœur. «Quand la vérité se révèle, la raison devient inutile et doit se retirer», assuraient les vieux scoliastes d'Alexandrie.
Dans ces conditions, «vouloir faire cadeau» de l'objet à vendre ne représente rien de plus que les manifestations qui font croire au client qu'il est considéré comme un ami de toujours. Derrière ces marques affectives, le réalisme égyptien ne perd jamais de vue le bénéfice à tirer de la transaction. L'argent demeure le maître mot, un mot qui est d'ailleurs passé dans notre argot, sinon dans notre langue. En égyptien, l'argent se dit felous.
Néanmoins, l'argent ne peut pas tout. Même si l'Egypte est la terre du bakchich, c'est aussi le pays où l'être humain n'est qu'une ombre et les choses rien du tout. Seul l'étranger persuadé de la toute-puissance de ses devises ne peut imaginer que le service le plus anodin peut se révéler irréalisable. Mebh momken, «ce n'est pas possible », est une formule qui revient souvent dans la conversation. Mais elle sera toujours suivie d'un Essai, «Excusez-moi»; ou d'un Ana mont asef, «Je suis désolé». Alors, si vous savez vivre, vous répliquerez Maleq, «Ça ne fait rien». Car, en définitive, vous savez très bien, avant même d'avoir formulé votre irréalisable exigence, que votre souhait est, de toute éternité, soumis à la volonté divine. Une chose se réalise «si Dieu le veut». Inch'Allah !